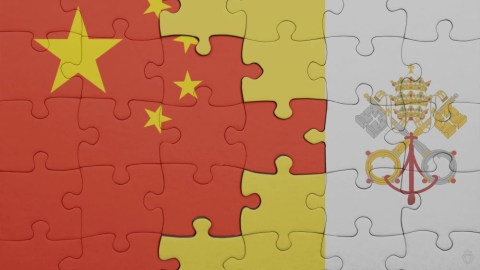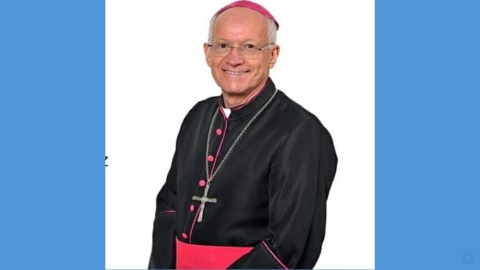Au cœur de l’Eglise : les cardinaux

Le 30 septembre 2023, le pape François doit présider un consistoire public ordinaire au cours duquel seront créés vingt-et-un cardinaux dont deux Français. C’est l’occasion de se pencher un peu plus sur la fonction de cardinal qui suscite tant de mystère et de fantasme dans la culture populaire.
Dans l’Eglise des premiers siècles, l’évêque, le prêtre et même un diacre pouvait porter le nom de cardinalis lorsqu’il était, par ses fonctions, attaché de façon stable à une église quelconque : ce lieu de culte était par rapport à lui le cardo, en latin le pivot, de son activité missionnaire. A partir du VIIIe siècle, on constate une légère évolution car le terme de cardinal sera réservé au clergé de la cité épiscopale.
Peu à peu, les cardinaux deviennent l’apanage spécial de l’Eglise de Rome qui est comme l’indique le pape Léon IX, le cardo par excellence, le cœur de la société fondée par Jésus-Christ pour le salut de ses membres.
Les cardinaux, pris dans leur ensemble, forment le Sacré-Collège, et c’est à certains d’entre eux – qui satisfont aux exigences du droit, concernant la limite d’âge par exemple – qu’il revient d’élire le successeur de Pierre, une coutume confirmée de façon solennelle par le pape Nicolas II, en 1059. De façon générale, leur mission est d’aider le pape dans sa mission de gouverner l’Eglise universelle.
Au pape seul il appartient de nommer – de créér – des cardinaux, après avoir demandé, s’il le juge à propos, l’avis des autres. Pour conférer aux élus leur nouvelle dignité, le souverain pontife organise un consistoire ordinaire public, cérémonie durant laquelle il impose aux nouveaux cardinaux une barrette rouge et un anneau afin de marquer qu’un cardinal doit être prêt à confesser la foi, fût-ce au prix de sa vie, et demeurer fidèle à l’Eglise comme un époux envers son épouse.
De quoi faire méditer plus d’un porporato aujourd’hui ! Porporato est un synonyme de « cardinal » qui fait référence à la couleur pourpre qui est l’un de ses attributs officiels depuis le pape Innocent IV, au XIIIe siècle.
Il existe, au sein du Sacré-Collège, trois « classes » de cardinaux : les cardinaux-évêques, les cardinaux-prêtres et les cardinaux-diacres. Ces classes ne sont pas fondées sur le pouvoir d’ordre – la plupart des membres du Sacré-Collège sont évêques – mais elles dépendent uniquement du titre ecclésiastique, c’est-à-dire de la paroisse de Rome, symboliquement assigné à chaque élu au moment de sa promotion.
Le collège des cardinaux est présidé par un doyen qui n’est pas le plus âgé des membres qui le composent, mais l’un des cardinaux-évêques, élu par ses pairs puis nommé par le pape : actuellement c’est le cardinal italien Giovanni Battista Re qui remplit cette fonction ; il est secondé par un vice-doyen, le cardinal argentin Leonardo Sandri.
Les cardinaux les plus anciens de chaque classe – cardinal proto-prêtre et cardinal proto-diacre – ont également des charges particulières : c’est ainsi au cardinal proto-diacre qu’il revient d’annoncer, à l’issue du conclave, le nom de l’élu.
Depuis le 17 septembre 2023, soit treize jours avant le consistoire du 30 septembre et date à laquelle le cardinal Angelo Comastri a atteint la limite d’âge de 80 ans qui lui a fait perdre son droit d’élire le pape, le collège cardinalice compte 221 cardinaux, dont 119 cardinaux électeurs et 102 cardinaux non-votants.
Related links
(Source : Dictionnaire de théologie catholique – FSSPX.Actualités)
Illustration : Centro Televisivo Vaticano, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons