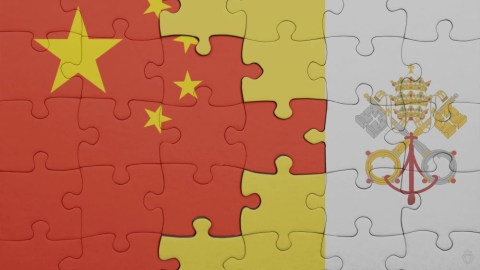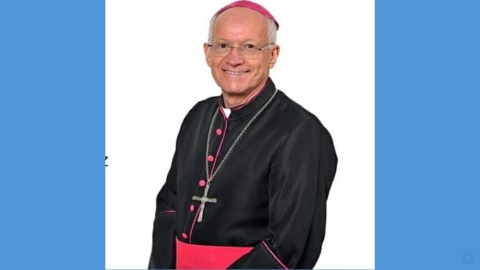Dans les coulisses du synode - semaine 2

Mgr Shane Mackinlay et le Pr Renée Köhler-Ryan
Les Australiens occupent le devant de la scène durant une semaine qui a vu les questions les plus délicates être examinées, sur fond de tensions que les points-presse quotidiens ont permis de déceler. Avec un point d’orgue, la prière très politique pour les migrants devant le synode qui s’est déplacé place Saint-Pierre dans l’après-midi du 19 octobre.
La deuxième semaine qui vient de s’achever a mis en relief le rôle joué par deux personnalités progressistes australiennes : Renée Köhler-Ryan, professeur à l’Université Notre-Dame, et Mgr Shane Mackinlay, évêque de Sandhurst chargé par le souverain pontife de participer à la rédaction finale de la synthèse synodale.
L’un et l’autre se sont réjouis, lors d’un point-presse, du fait que le synode ait abordé la question sensible de l’ordination diaconale des femmes : « je suis content que le sujet soit sur la table, il est important que cela soit discuté au niveau de l’Eglise universelle », a déclaré l’évêque de Sandhurst.
En raison de la méthodologie choisie, on ne dispose d’aucune indication précise du degré de soutien des propositions visant à avancer sur le thème de l’ordination des femmes, ni si ces propositions émanaient plutôt des clercs ou des laïques présents aux réunions. Ce qui est sûr, c’est que les débats de cette semaine ont illustré le principe synodal – confinant à l’incantation – selon lequel « tout peut se dire et doit être écrit, car pouvant être inspiré par le Saint Esprit ».
Pour couper court aux rumeurs persistantes d’un synode biaisé, le Père Vimal Tirimanna – théologien moral et conseiller théologique du synode – a été dépêché en urgence le 16 octobre auprès des journalistes, afin d’expliquer que « ce synode n’est pas le reflet d’un agenda caché du pape François, mais s’inscrit dans le sillage de Vatican II ». Une précision qui en dit long sur le fait que les organisateurs ont bien conscience de marcher sur des œufs.
C’est ce que confirme indirectement Mgr Mackinlay : « A la fin de chaque réunion de groupe, il ne nous est pas demandé de voter pour savoir si nous sommes d’accord avec tout ce qui est écrit dans le rapport, mais si le rapport est une présentation précise de la discussion du groupe. » Un aveu qui montre à lui seul la fragilité du processus synodal.
Mgr Zdenek Wasserbauer, évêque auxiliaire de Prague met également le doigt sur les divergences qui se font jour : « ce qui importe, c’est que personne ne se fâche lorsqu’une opinion différente est exprimée, et que chacun puisse exprimer librement sa propre conviction, sa propre persuasion ».
Des propos précisés par Sœur Patricia Murray, secrétaire générale de l’Union internationale des supérieurs généraux (UISGa) qui reconnaît, entre deux réunions, que des « opinions très diverses » ont été exprimées et que « certaines tensions » se sont fait jour.
L’effervescence était en tout cas plus que jamais de mise dans les couloirs du synode, le 17 octobre dernier : ce jour-là, les participants ont discuté de la fonction épiscopale et de la possibilité pour des laïcs d’interférer dans la nomination des prélats. A quand l’élection de l’évêque au suffrage universel réalisé via son smartphone ?
Afin de libérer un peu la pression de la cocotte-minute synodale, rien de plus bénéfique que de prendre un bon bol d’air : le 19 octobre, le Saint-Père en personne a donc repris la main en convoquant tous les participants à un « moment de prière pour les migrants et les réfugiés », sur une place Saint-Pierre fermée aux touristes pour l’occasion.
Devant 500 personnes, François a plaidé la cause des migrants « volés, dépouillés et battus en chemin », comme l’est « le voyageur agressé dans l’épisode biblique du Bon Samaritain », qui a décidément bon dos de voir son message « récupéré » ainsi.
Le pontife argentin a repris une posture aussi politique qu’utopique, exigeant la multiplication des « voies de migration régulière », avec la traditionnelle minute de silence qui a suivi, « à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie le long des différentes routes migratoires », mais aussi « pour tous ceux qui ont été utilisés, réduits en esclavage ».
Articles Liés
(Sources : Catholic weekly/National Catholic Register/Crux – FSSPX.Actualités)
Illustration 1 : Diocèse de Sanhurst
Illustration 2 : World Economic Forum