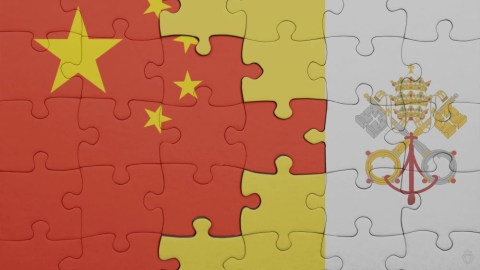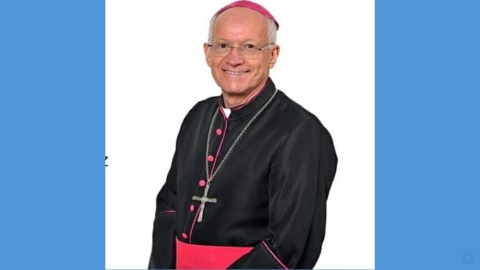Bande de Gaza : quand un pontificat atteint ses limites

La rencontre du pape François avec les délégations israélienne et palestinienne le 22 novembre 2023 a engendré la controverse, les chefs de file du judaïsme en Italie dénonçant, dans l’attitude du pontife romain, une façon de relativiser la portée des attentats terroristes perpétrés par le Hamas, le 7 octobre dernier. Au-delà, c’est toute la gouvernance de l’actuel pontificat qui est mise en question.
La polémique causée par des propos du souverain pontife, rapportés par la partie palestinienne, pose la question du degré d’implication de la secrétairerie d’Etat et des diplomates du Saint-Siège dans l’organisation de l’audience du 22 novembre 2023. Question importante : la coordination entre le successeur de Pierre et ses services diplomatiques reste ignorée.
Pour l’historien des religions Massimo Faggioli, professeur au Département de théologie et d’études religieuses de l’Université Villanova de Philadelphie (Etats-Unis), et auteur de plusieurs ouvrages sur le catholicisme, « dans le rapport au judaïsme et à l’islam, on ne peut pas s’appuyer sur des scénarios issus du passé, ni improviser. Nous avons besoin d’un pontife moins généreux en paroles, plus réfléchi et attentif. »
Un pontife notamment attentif, pourrait-on ajouter, à écouter les services diplomatiques du Saint-Siège rompus aux situations internationales les plus complexes, alors que depuis 2013 s’est opérée au contraire une marginalisation progressive de la secrétairerie d’Etat.
Ce qui s’est passé le 7 octobre dernier ouvre une séquence particulièrement délicate, de nature à modifier la donne en termes de dialogue avec le judaïsme et l’islam, au point de remettre en cause la gestion très « personnelle » du pape François : selon l’historien italien, « il y a des limites et des conséquences pour un pontificat à traiter ces choses à un niveau très personnel. Ceci, de mon point de vue, est une limite.
« C’est un style qui peut fonctionner avec d’autres types d’interlocuteurs, mais ici je crois qu’il y a des limites et aussi un prix à payer en termes d’incompréhensions et de tensions qu’il vaudrait mieux éviter. (…) Une chose est de négocier avec des entités de droit international, une autre de s’adresser à un diocèse, un monastère ou un mouvement ecclésial. »
Un pape isolé et critiqué
D’où l’image actuelle d’un pape particulièrement solitaire qui apparaît en première ligne dans de nombreux dossiers, et qui par là même se place directement sous le feu des critiques, parfois vives et sans filtre, à son encontre. L’actualité récente ne manque malheureusement pas d’exemples en ce sens, et ont souvent pour effet d’amoindrir le prestige de la fonction papale.
C’est ce que note Massimo Faggioli : « Je crois que François gouverne d’une façon plus isolée que celle de ses prédécesseurs. Du temps de ces derniers, il y avait l’“appartement pontifical”, avec un secrétaire visible et identifiable ayant une fonction de filtre. Cela a disparu : aujourd’hui le secrétaire du pape a une fonction à géométrie variable, sans visibilité. Et le rôle de la Curie romaine reste obscur sous l’actuel pontificat. »
La réforme de la Curie romaine promulguée en 2022 a singulièrement affaibli la fonction de secrétaire d’Etat et recentré la Curie sur le pape. Une dimension confirmée par la promulgation de la loi fondamentale de la Cité du Vatican en mai dernier. Deux impératifs contradictoires se font face : d’une part l’Eglise doit être « en sortie » en devenant « synodale », d’autre part elle doit demeurer centrée sur la personne même du pape qui n’hésite pas à décider seul en toute « verticalité ».
« C’est là l’un des effets d’une ecclésiologie selon laquelle l’Eglise est un peuple avec lequel le pape est en relation directe », avance Massimo Faggioli comme hypothèse de travail. Une forme de « péronisme ecclésiastique » pourrait-on ajouter.
Pour résumer de façon très succincte les dix ans de l’actuel pontificat, on pourrait encore citer Massimo Faggioli : « Ma thèse sur ce pontificat est qu’il représente une phase de très forte accélération vers la mondialisation du catholicisme. (…) C’est un catholicisme plus global, moins européen, plus multiculturel, plus diversifié, mais aussi plus difficile à maintenir ensemble. (…) C’est un moment historique car l’Eglise change de visage, au sens littéral. » Au risque de sortir défigurée de ce lifting d’un genre nouveau.
(Source : Huffington Post – FSSPX.Actualités)
Illustration : Photo 62794135 © Michal Bednarek | Dreamstime.com