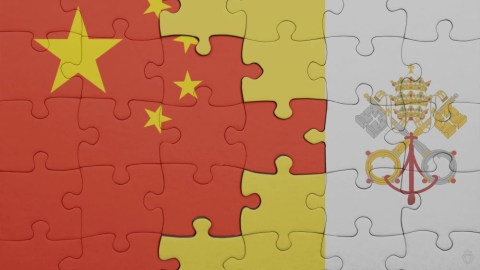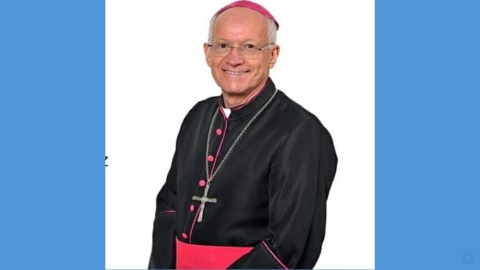L’exhortation “Laudate Deum” : c’est Laudato si’ en pire

Annoncant sa future exhortation apostolique, parue le 4 octobre 2023, en la fête de saint François d’Assise, le pape François l’avait décrite comme « une deuxième partie de Laudato si’ pour une mise à jour des problèmes actuels ». Pour juger ce nouveau texte sur l’écologie, il faut reprendre Laudato si’ dont il est la suite.
L’encyclique Laudato si’
Le constat d’une faillite universelle
Le texte constate « une défaillance politique générale » : le pape conclut que le système politique actuel est obsolète, à cause de la prédominance de la dimension économique sur le politique. Le pape vise l’appât du gain, déformation de l’économie, ainsi que le consumérisme.
L’encyclique cible la technique comme nouvelle idole : le pape reprendra souvent ce thème. Il parle de « globalisation du paradigme technocratique ». Le pape voit les causes dans l’anthropocentrisme qui met la technique au-dessus de la réalité, et dans le scepticisme qui abolit la vérité.
Une critique orientée par une certaine vision du monde
Le point de vue de l’encyclique reste purement naturel : l’analyse est d’inspiration socio-écologique ; elle se contente de constater la cupidité des hommes, mais oublie d’en donner la raison, qui est d’ordre théologique : les blessures du péché originel, spécialement le désir immodéré des richesses.
Le texte projette l’ombre de la théologie de la libération à la sauce écologique, tombant peu ou prou dans l’erreur qu’il entend critiquer : le scientisme vert devient la pensée dominante. Enfin la cause théologique est absente : ne pas mentionner le Christ, c’est rester au niveau du relativisme.
Le concept de l’écologie selon François
La conception papale de l’écologie recouvre ce que la philosophie caractérise comme sciences pratiques : la technique d'une part, et l’agir, domaine de la morale ; c’est donc une tentative de synthèse des sciences humaines : politique, culture, sociologie, économie, finances, écologie.
Cela fait penser à la synthèse d’Auguste Comte (1798-1857), fondateur du positivisme, qui voyait dans la sociologie le couronnement de tout le savoir humain. De même, pour François, ce serait l’écologie intégrale, qui serait le couronnement de toute les sciences sociales.
La catastrophe écologique et ses causes
La dénonciation de la « grande détérioration de notre maison commune » occupe la majeure partie de l’encyclique. Elle recense les atteintes à l’écologie et en détaille leurs causes : après un « manuel écologiste », la cause politique, est située dans l’opposition Nord/Sud. Les causes ultimes gisent dans la globalisation du paradigme technocratique, l’hégémonie de l’économie, et l’anthropocentrisme.
Les remèdes à la situation actuelle
Le Pape recommande la mise en place d’une « véritable Autorité politique mondiale », suivant l’exemple de Jean XXIII et de Benoît XVI. Il réclame aussi des changements sociaux profonds pour éduquer au respect de l’écologie, ainsi que des changements individuels, dont le modèle est la Charte de la Terre, texte affligeant et pétri de mots vides.
L’utopie écologique du pape François
L’enseignement pontifical a toutes les caractéristiques d’une vaste utopie “écologique”. Utopie par l’urgence avec laquelle elle est proclamée, par l’universalité affichée : il s’agit de revoir totalement l’ensemble des processus politiques, économiques et technologiques, mais aussi anthropologiques, éducatifs, philosophiques et spirituels ! Un véritable reset…
La raison profonde pour laquelle le pape poursuit une utopie a trait à sa vision du futur : prétendre réaliser un monde juste « pour demain », repose sur une illusion d’inspiration libérale et maçonnique, de type « socialiste ». C’est un refus de la royauté du Christ et de sa grâce, implicite ou conceptualisée.
Une utopie millénariste et pélagienne
Il faut rappeler que Notre Seigneur Jésus-Christ n’a jamais présenté son royaume comme la restauration de la félicité édénique – qui évoque le paradis terrestre, le jardin d’Eden. Cette vision est opposée à l’Evangile, et suppose une sorte de millénarisme.
Quant au plan personnel, la participation au bien commun est présentée comme un acte de charité et une « expérience spirituelle intense ». Il y faut un progrès individuel, des vertus personnelles et sociales qui sonnent comme un retour à la justice originelle.
C’est bien là l’utopie la plus grave : un pélagianisme caractérisé et inextirpable. La « conversion » générale à laquelle François aspire, est conçue sans l’aide de Dieu. Comment envisager une « civilisation de l’amour », une « fraternité universelle » ou une « nouvelle synthèse » sans la grâce ? C’est oublier et mépriser la Royauté universelle du Christ, seul capable de restaurer l’homme blessé.
* Le pélagianisme : doctrine du moine Pélage (350-420), qui affirmait la possibilité de suivre la loi divine sans l’aide de la grâce. Il fut combattu par saint Augustin et condamné par le pape Zosime.
L’exhortation Laudate Deum
Ce nouveau texte tourne quasi-exclusivement sur la crise climatique, comme l’annonce d’ailleurs son sous-titre. Mais cette préoccupation tourne à l’obsession : c’est un véritable « cours de climatologie » où il est question de température, de changement climatique, de défense farouche de la cause du réchauffement et d’accusation contre ceux qui le nieraient…
La cause de ce changement est anthropique - d’origine humaine, affirme François : il est alors longuement question de gaz à effets de serre, avec une nouvelle charge contre les contestataires. Suivent les dégâts sur les glaciers, les banquises, les flux océaniques… et nous voilà presqu’au tiers du document.
Le point suivant reprend la question du « paradigme technocratique » et de la nécessité de repenser le pouvoir humain et ses limites. Ce qui amène la constatation de la faiblesse de la politique internationale et de la nécessité d’initier « un nouveau processus de prise de décisions et de légitimation de celles-ci », car ce qui a été déjà mis en place est insuffisant.
Le Pape passe ensuite aux Conférences sur le climat (COP), leurs réussites partielles et leurs échecs. Il faut constater que « les accords n’ont été que peu mis en œuvre parce qu’aucun mécanisme adéquat de contrôle, de révision périodique et de sanction en cas de manquements, n’a été établi ». C’est pourquoi François se tourne vers la COP 28 de Dubaï, mais en restant assez sceptique sur le résultat.
Le document se conclut sur des « motivations spirituelles » bien pauvres. François insiste surtout in fine sur la nécessité de marcher en commun, et sur le changement culturel à promouvoir qui doit permettre une nouvelle attitude globale.
Ce texte répète de manière criante les déficiences de Laudato si’. Et d’abord, un enseignement hors de la sphère du magistère : le climat ne fait pas vraiment partie du corps de la Révélation divine. Ensuite, le fait de s’étendre de cette manière dans un domaine où l’on n’a que la compétence de ceux qui vous ont aidé, est pitoyable, et n’aura que bien peu d’impact.
Enfin et surtout, si le Pape veut sauver la planète, il doit commencer par prêcher Jésus-Christ qui est la seule solution : la vertu, en particulier la justice et la prudence, appartiennent à Celui qui est la Voie, la Vérité et la Vie. Sans cette grâce divine qui nous sauve pour l’éternité et qui nous guide ici-bas, il n’y a rien ou pas grand-chose. Nous baignons toujours dans le même pélagianisme impuissant.
(Source : Vatican.va – FSSPX.Actualités)