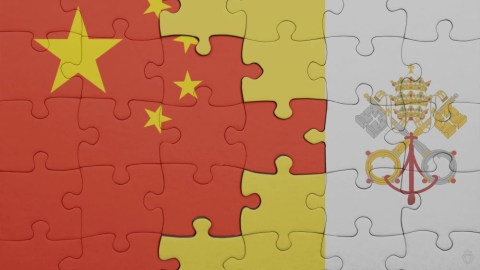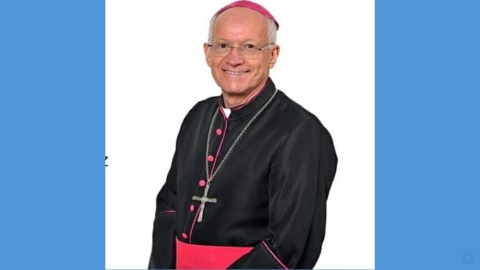Revue de presse : que s’est-il passé au synode sur la synodalité ? (4)

Le Père James Martin
Du 4 au 29 octobre 2023, s’est tenu à Rome le synode sur la synodalité. Il s’agissait en fait de la première phase d’un synode qui se réunira à nouveau en octobre 2024, et qui sera suivi de l’exhortation post-synodale du pape reprenant ce qu’il voudra du document de synthèse que lui remettront les pères et mères synodaux – car ce synode est, pour la première fois, ouvert aux femmes, religieuses et laïques.
Au terme de cette première étape, on peut tirer quelques conclusions qui pour être provisoires n’en sont pas moins révélatrices de l’état d’esprit qui anime les organisateurs du synode.
Le témoignage éloquent du père Martin
La meilleure illustration de la praxis à l’œuvre au synode est fournie par le père James Martin s.j., ardent militant de l’accueil des homosexuels par l’Eglise, dans un témoignage publié par la revue jésuite America, le 30 octobre. Il était l’invité du pape, et il s’est beaucoup plu au synode.
Voici comment il considère les « conversations dans l’Esprit » dont les pères synodaux devaient faire l’expérience : « Nous avons commencé par une retraite au centre de retraite Fraterna Domus, dirigée par le Père Radcliffe, ancien maître général des Dominicains, et Mère Maria Ignazia Angelini, une sœur bénédictine italienne.
« Contrairement à la plupart des retraites, celle-ci comprenait non seulement des prières et des instructions, mais aussi une introduction à la principale méthode de participation au synode, appelée “conversations dans l’Esprit”. Ces conversations, plus que toute autre chose, ont été la principale contribution du synode à l’Eglise.
« Il m’a fallu un certain temps pour comprendre que le synode sur la synodalité portait moins sur des questions, même importantes, que sur la manière dont nous discutions de ces questions. Ainsi, le message le plus puissant du synode a été l’image de 350 délégués assis à des tables rondes, parlant les uns avec les autres et, plus important encore, s’écoutant les uns les autres. »
Sur le même sujet :
Après la théorie, les pères et mères synodaux passaient aux travaux pratiques de « conversation dans l’Esprit », autour d’une table : « Nous avons trouvé utile de demander à chacun le nom qu’il souhaitait se voir attribuer aux tables. C’est peut-être moins urgent dans une paroisse, mais c’était important ici, avec tant d’éminences et d’excellences, ainsi que de professeurs et de pères.
« En général, ils disaient : “Appelez-moi Jim”. “Appelez-moi Chito”. “Appelez-moi Cynthia”. Ensuite, chacun a fait un tour de table et, pendant trois minutes (strictement chronométrées), a donné sa réponse à la question posée. Nos questions étaient tirées du document de travail, ou Instrumentum laboris – par exemple, “Comment une Eglise synodale peut-elle rendre crédible la promesse que ‘l’amour et la vérité se rencontreront’ ?”
« Personne ne pouvait interrompre et tout le monde devait écouter. Cela signifie que le cardinal archevêque a écouté un étudiant de 19 ans du Wyoming. Ou que le patriarche ou le primat d’un pays a écouté une femme professeur de théologie. A ce stade, il n’y a pas d’interruptions, de réponses ou de discussions.
« Lors du deuxième tour, après une nouvelle prière, nous avons partagé ce que nous avions entendu, ce qui nous avait émus et les résonances que nous avions ressenties au cours de la discussion. Où l’Esprit se manifestait-il ? Là encore, pas d’interruptions. J’étais à des tables où l’animateur (il est utile d’en avoir) disait : “Cardinal, elle n’a pas encore fini.”
« Enfin, la troisième session était une discussion plus libre, où nous pouvions répondre aux questions, partager nos expériences et nous défier les uns les autres.
« Le génie de cette méthode réside dans sa capacité à restituer honnêtement la réalité complexe de nos discussions. Un secrétaire rédigeait les convergences, les divergences, les tensions et les questions. Ensuite, un rapporteur présentait la discussion de la table en séance plénière. De cette manière, il n’était pas nécessaire de forcer un faux consensus lorsqu’il n’y en avait pas ; au contraire, les différences et les tensions étaient communiquées honnêtement.
« J’ai trouvé cela rafraîchissant. Cette méthode signifie que tout le monde a été écouté, que tout le monde a eu sa chance et qu’un résumé honnête a été proposé pour une réflexion plus approfondie. » […]
« Alors que nous étions assis dans la grande Aula Paul VI et que nous voyions tout le monde discuter sur un pied d’égalité, avec le pape lui-même à une table ronde, j’ai réalisé que le message du synode est cette méthode, qui pourrait aider l’Eglise de manière incommensurable en ces temps de grande polarisation. »
Sur le même sujet :
Naïveté ou roublardise de la part de ce jésuite, fervent avocat des homosexuels dans l’Eglise ? La réponse vient dans la suite du témoignage où il dit sa déception de ce que la question LGBTQ n’ait pas été vraiment traitée. Il déclare : « l’absence de toute mention du terme LGBTQ dans la synthèse finale, intitulée Une Eglise synodale en mission, a été, pour beaucoup de gens, y compris moi-même, une déception. […]
« De mon point de vue, j’aurais souhaité que la synthèse reflète davantage la richesse de la conversation autour du sujet et admette nos divergences, comme cela a été fait dans d’autres domaines controversés.
« En raison de l’opposition farouche à ce sujet, la synthèse a plutôt parlé de “sexualité et d’identité”. Pourtant, elle demande à l’Eglise d’entendre le désir des catholiques LGBTQ (ainsi que d’autres groupes) d’être “entendus et accompagnés”, et de faire de l’Eglise un lieu où ils peuvent “se sentir en sécurité, être entendus et respectés, sans être jugés”, après avoir été “blessés et négligés”.
« Le synode précise que “parfois, les catégories anthropologiques que nous avons développées ne sont pas en mesure de saisir la complexité des éléments qui émergent de l’expérience ou de la connaissance scientifique et nécessitent une plus grande précision et une étude plus approfondie”.
« Il est important, disent les membres du synode, “de prendre le temps nécessaire à cette réflexion et d’y investir nos meilleures énergies, sans se laisser aller à des jugements simplistes qui blessent les personnes et le corps de l’Eglise”. »
L’important, pour lui, est que « le texte [soit] une porte ouverte à la poursuite de la conversation par le synode lors de notre prochaine session et par l’Eglise. » Et de conclure à la façon d’Embrassons-nous, Folleville ! d’Eugène Labiche : « A la fin de nos discussions, il n’y avait pas beaucoup de points communs [sur la question LGBTQ], mais il y avait de l’amitié et du respect, et nous nous sommes salués à partir de ce moment-là.
« A un moment donné, j’ai rencontré le cardinal Gerhard Müller, dont l’approche des questions de LGBTQ est assez [sic] différente de la mienne. J’ai pu lui dire sincèrement que j’admirais son travail avec le théologien de la libération Gustavo Gutiérrez, et plus tard dans la journée, nous avons échangé des livres et nous nous sommes fait photographier ensemble. Cela changera-t-il l’Eglise ?
« Peut-être pas, mais c’est un début, et c’est peut-être quelque chose de bon dans un monde polarisé. Le père Radcliffe a déclaré que sans amitié, nous ne parviendrons à rien. Il a ensuite cité une belle phrase de Jean-Paul II : “La collégialité affective précède la collégialité effective”. »
(Sources : America/DICI n°438 – FSSPX.Actualités)
Illustration : Flickr / Shawn CC BY-NC 2.0