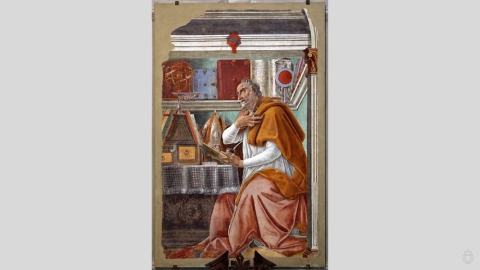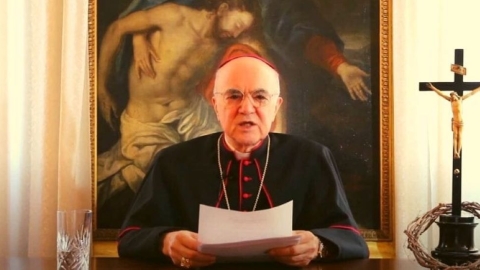Les JO 2024 dessinent l’effacement du christianisme

En gommant la croix surmontant le dôme des Invalides de l’affiche des JO de Paris 2024, le comité d’organisation de l’événement planétaire qui doit se tenir en France d’ici quelques semaines, souligne, peut-être sans s’en rendre compte, l’effondrement de la matrice catholique de la France. Ultime symptôme de la modernité que l’Eglise n’est pas parvenu à contrecarrer.
Depuis plusieurs mois, les débats se multiplient dans la presse française sur l’organisation des Jeux olympique : achèvement des installations, impréparation et coût des transports, conséquences sur le prix du logement, organisation et sécurité de la cérémonie d’ouverture sur la Seine, sans parler du risque d’une dérive incontrôlable du budget d’investissement, les craintes ne manquent pas.
Au-delà des peurs légitimes, une autre musique se fait entendre : celle d’une France qui a perdu ses racines, comme on perd la tête. Il n’y a pas lieu de revenir sur le choix polémique de l’artiste censé incarner le génie français lors de la cérémonie d’ouverture, mais plutôt sur cet effacement du christianisme qui est devenu criant depuis le dévoilement de l’affiche officielle des Jeux.
Dessinée par l’illustrateur Ugo Gattoni, et diffusée depuis quelques semaines, l’affiche représente, dans un style qui se revendique surréaliste, de nombreux symboles et monuments français, dont la tour Eiffel ou encore l’Arc de triomphe.
Un détail, vite relevé par les médias et par quelques personnalités politiques – mais non par les évêques qui se sont officiellement refusés à tout commentaire – n’a pas tardé à créer un malaise : en arrière-plan, sur la gauche, le dôme des Invalides a été amputé de la croix qui le couronne.
Le Comité d’organisation des Jeux a expliqué, pour se défendre de toute interprétation malveillante, que l’œuvre constituait « une interprétation artistique joyeuse, légère, d’une ville-stade réinventée ». La croix du dôme qui évoque la joie de la Résurrection et de la Rédemption du gendre humain, serait-elle chargée d’une si grande tristesse que l’artiste ait décidé de la gommer ?
Ugo Gattoni a donné une clé de compréhension de cette omission : « Je ne cherche pas à ce que [les objets et bâtiments] soient fidèles à l’original, mais plutôt qu’on puisse se figurer en un clin d’œil de quoi il s’agit, tout en le projetant dans un univers surréaliste et festif. Je les évoque tels qu’ils m’apparaissent à l’esprit, sans arrière-pensée. »
En d’autres termes, dans l’imaginaire de cet artiste, l’un des plus importants monuments religieux et historiques de la capitale n’évoquerait pas davantage, en définitive, qu’un bâtiment plutôt esthétique recouvert de 12 kg d’or fin…
Une illustration de cet effondrement de l’ancienne matrice catholique de la France, dont Jérôme Fourquet faisait le constat en 2019 dans L’archipel français : il y montrait comment l’écologie consacrait l’émergence d’une nouvelle matrice, séculière et non plus religieuse, où les « sanctuaires de la biodiversité » ont remplacé les anciens lieux de culte, et où la « conversion à la transition énergétique » fait oublier celles, à Dieu, de Charles de Foucauld, de Péguy et de Claudel.
Une dislocation de la matrice catholique qui peut s’envisager sous l’angle d’une « exculturation » du catholicisme, pour reprendre le néologisme de la sociologue Danielle Hervieu-Léger, c’est-à-dire d’un découplage silencieux entre la culture catholique et la culture commune qui a fait perdre à l’Eglise sa capacité d’alimenter le tissu culturel vivant de la société, au-delà de ses seuls fidèles.
Un divorce qui acte le triomphe d’une modernité face à laquelle l’Eglise a voulu déployer les charmes de l’aggiornamento plutôt que la Tradition assumée. Le charmeur n’a pas tardé à se faire mordre par son serpent, et l’Eglise qui se pensait comme une solution à la crise, s’y est retrouvée plongée.
Heureusement, l’Eglise a reçu les promesses du Fils de Dieu et les signes ne manquent pas, ici ou là, d’une persistance et d’une vivacité du catholicisme attaché à ses traditions, et pour qui l’essentiel n’est pas de « participer », comme le voulait Pierre de Coubertin, mais de faire remonter le Christ sur la plus haute marche.
(Sources : Reuters/francetvinfo/AFP – FSSPX.Actualités)
Illustration 1 : citoyens.com
Illustration 2 : Daniel Vorndran / DXR, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons